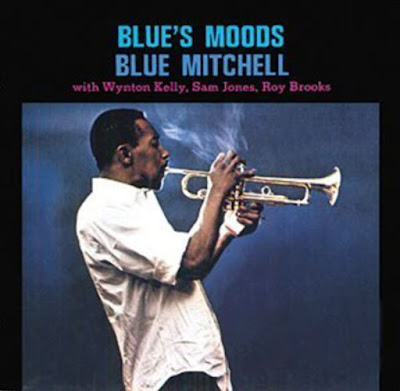24 janvier 2026
Grateful Memories
24 décembre 2025
Driving Home For Christmas
13 décembre 2025
Black & White Soul
30 octobre 2024
Deux heures avec Bob Dylan
23 mars 2024
Aya voir du Sport !
Décidément, tout fait polémique dans ces Jeux Olympiques 2024 de Paris.
31 décembre 2023
Everblue
24 octobre 2023
Still Rolling
A l’instar du chaos ambiant, rien ne s’oppose au mélange des genres, surtout s’il s’agit de musique qui, comme chacun sait, adoucit les mœurs…
Quoiqu'on en dise, un inédit des Rolling Stones, c'est un évènement. Inutile d'insister sur la carrière fabuleuse de ce groupe pop issu des sixties. Sans doute ces garçons devenus octogénaires n'ont-ils plus rien à démontrer, et sans doute leur initiative peut paraître quelque peu décalée par rapport à la mode actuelle.
N'est-ce pas l'album de trop ?
La jaquette à l'esthétique laquée mais impersonnelle et stéréotypée, n'a pas grand intérêt. Encore qu'on pourrait trouver à ce cœur de diamant brisé en mille morceaux par un couteau acéré, quelque allusion à la violence de l'actualité et l'explosion de haine à laquelle on assiste consterné.
S'agissant de la musique, en dépit d’assez nombreuses médiocres critiques, force est de constater que ça fonctionne encore, même si on a sans doute perdu un peu du grain de folie et d’ardeur juvénile qui faisait le sel du groupe de rock. Sex, drug and rock'n roll, le cocktail s'est bien affadi et le temps n'est plus celui du Flower Power.
Mais ça sonne encore bien. La musique regorge de rythme et d’énergie et le timbre inimitable de la voix de Mick Jagger est intact. Quand il n'éructe pas un rock acide et tonitruant, ses effets inimitables, mêlant lascivité et gémissement, sortent avec délectation de sa bouche à la fois sensuelle et carnassière. Les rides, l’émaciation des chairs n’ont en rien altéré la force du chant.
Dans cette collection de nouveaux titres on compte des rocks aux riffs bien agressifs, très entraînants à défaut d’être d’une originalité renversante : Angry, Get Close, Bite My Head Off (avec la participation robuste de Paul McCartney), Mess It Up, Whole Wide World.
Il y en a d’autres plus circonstanciés et pulpeux : Depending On You, Live By The Sword, Drive Me Too Hard
Il y a enfin de bonnes vieilles ballades langoureuses, telles Dreamy Skies, Sweet Sounds Of Heaven (on peut y entendre s’égosiller Lady Gaga et pour ceux qui ont l’oreille fine, le piano d’Elton John…).
Et avant de partir, deux petits blues. L’un susurré avec modestie et tendresse par Keith Richards (Tell Me Straight), l’autre résonnant comme l'oméga d’une aventure commencée dans le sillage du bon Muddy Waters : Rolling Stone Blues. En définitive; si les Stones ne se réinventent pas, ils font mieux qu’entretenir la flamme, ils l’attisent. Ça fait revenir des souvenirs enfouis des belles années passées trop vite, ce n’est pas si mal…
Par un hasard bienvenu, j’ai découvert via Youtube, un titre jamais édité, datant de 1997, Dream About. Incontestablement, il émane de cette chanson méconnue, un jus à la saveur supérieure à celle des décoctions présentes. Ligne rythmique hypnotique, petits accords acidulés à la guitare, et une mélodie ensorcelante, pour ne pas dire poignante, qui fait monter encore un peu plus la nostalgie...
18 octobre 2023
Intermède Goldberg
Pour échapper à l’horreur de l’actualité, au vertige de la barbarie et du non sens qui tel un trou noir nous aspire de plus en plus, je reviens donc à mon alpha, qui sera sans nul doute également l’oméga de mon destin, si tant est que je puisse pleinement en profiter jusqu’aux confins de mon existence terrestre.
La publication toute récente d’une nouvelle version de ce chef-d'œuvre par le pianiste danois Vikingur Olafsson donne l’occasion de plonger à nouveau dans cet absolu de bien et de beauté.
On retrouve sous les doigts de cet artiste, la grâce unique faite de légèreté, de fantaisie et d’inventivité qui ne sacrifie rien à la fidélité, mais qui la transcende et l’illumine. Il y a une puissance à la fois grave et joyeuse qui vous transporte quasi instantanément. Tout en faisant indéfectiblement partie d’un ensemble, chaque variation s’individualise à merveille comme un monde à part entière, empli d’une troublante évidence. Certaines sont époustouflantes de virtuosité (variation 1 et 5 enlevées avec tant de gourmandise qu'on les entend à peine passer, et 20, superbe), d’autres de profondeur (3, 13, 15, 21, 25, ainsi que le crescendo dramatique des dernières variations, et bien sûr l’énigmatique et envoûtante aria qui commence et qui termine le parcours). La prise de son est idéale, très précise, d'une pureté quasi cristalline, avec juste ce qu’il faut de réverbération et de rondeur.
Il y a tant d'interprétations à ce jour qu’il est bien difficile de savoir ce qu’apporte un énième regard, et pourtant…
Cette nouvelle exploration constitue assurément un trop bref moment d’extase et de plénitude…
29 mai 2023
Des Insoumis, des vrais
Jean-Louis Murat (1952-2023) et Tina Turner (1939-2023) se sont dressés de toutes leurs forces contre un destin contraire et, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, ont puisé leur énergie dans les épreuves. Par amour propre ils n’hésitèrent pas à sortir des chemins balisés, à se priver de toute facilité, et refusèrent tout assujettissement.
Résultat, leurs parcours furent quelque peu chaotiques mais chacun à sa manière, a laissé dans son sillage quelques pépites inoubliables qui doivent tout à leur talent et à leur énergie.
Tina Turner donna un nouveau souffle puissant, décapant, au Rhythm 'n Blues. Point n’est besoin de trop insister sur cette carrière qui atteignit les cimes de la notoriété internationale.
Il sera ici davantage question de celle de Jean-Louis Murat, beaucoup plus confidentielle.
On peut certes expliquer cette discrétion par la volonté de l’artiste de fuir les sunlights et les grands médias, pire, de manifester des mouvements d’humeur homériques à l’encontre des grands circuits de production et de se livrer parfois à de violentes critiques ad hominem.
Le fait est que contrairement à beaucoup d’artistes prétendument engagés, Murat sut éviter tout embrigadement politique : "Je n’ai jamais été de gauche une seule minute dans ma vie, mais je n’ai jamais été de droite non plus", affirmait-il.
S’agissant de la protection de l’environnement, à laquelle sa nature paysanne était très attachée, il s’insurgeait toutefois de voir la cause dévoyée par “les nullards” ultra médiatisés aux discours bien éloignés des actes.
N'hésitant pas à braver le consensus politiquement correct, il ne dédaignait pas de jeter quelques pavés dans la mare: "Je suis très pro américain, un peu pour la provoc. Je fais partie des 3% de Français qui étaient pour l’intervention en Irak…"
Derrière les éclats de voix, et les controverses tonitruantes, Jean-Louis Murat était néanmoins un artiste très sensible, dont les chansons révélaient une âme à fleur de peau, un talent poétique rare à notre époque, le tout magnifié par une musicalité exquise et une voix suave aux accents frissonnants quoiq'un peu désabusés.
Pour ma part, au sein d’une production pléthorique, qui mériterait d’être mieux connue, je retiens comme un petit trésor son album Le Manteau de Pluie qui m’avait séduit lors de sa sortie il y a déjà bien longtemps. Je ne me lasse pas des mélopées sensuelles qu'il recèle: Sentiment Nouveau, Col de la Croix-Morand , l’Ephémère, Cours Dire aux Hommes Faibles, L'Infidèle, le Lien Défait...
En somme, jamais Jean-Louis Murat ne sera pour moi un artiste maudit. Et après tout, quelqu’un qui aime l’Amérique, le Blues et Baudelaire ne peut être foncièrement mauvais...
13 janvier 2023
In Memoriam Jeff Beck
Cet artiste excentrique, héros fondateur, avec Eric Clapton, du groupe mythique Yardbirds était unique en son genre.
Il n’avait pas son pareil pour déstructurer tout en les magnifiant les thèmes auxquels il s’attaquait, envoutant son public, le noyant pour ainsi dire sous un flot de divines harmonies. Ne cédant jamais à la facilité, il alternait avec talent les rythmes, les sonorités, peuplant de manière jubilatoire l’espace avec sa musique, souple, ample, tantôt grave, tantôt suraiguë, parfois fragile, parfois en équilibre instable, mais retombant toujours comme par magie sur ses pieds. Maître du vibrato, il en fit un instrument à part entière, imprimant de manière indélébile son style inimitable dans les oreilles de ceux qui eurent la chance de l'entendre ne serait-ce qu'une fois.
On peut se faire une idée de son art en écoutant son interprétation irénique du Nessun Dorma de Puccini, ou bien l’ensorcelant A Day In The Life, titre célébrissime de l’album Sergeant Peppers des Beatles. On peut écouter avec délectation sa version à l’hawaïenne, du fameux Apache des Shadows, ou encore celle transfigurée de Caroline No, popularisé autrefois par les Beach Boys. Citons aussi un concert génial qu’il donna au Ronnie Scott’s à Londres en 2007, durant lequel il montra sa maîtrise du Blues autant que du Jazz en accompagnant notamment les chanteuses Imogen Heap dans un Blanket ruisselant de feeling et Joss Stone dans une reprise très soul du fameux People Get Ready. Enfin, plus récemment, Jeff se produisit en compagnie du groupe ZZ Top pour interpréter le torride Rough Boy.
Hélas ce mardi 10 Janvier, Jeff Beck, frappé par une maladie injuste et brutale, a lâché le manche de sa guitare pour rejoindre des cieux qu’on voudrait voir sans fin zébrés par l'éclat de ses riffs somptueux…
30 novembre 2022
Late November Blues
Le blues ne s’exprime jamais mieux et plus directement qu’en musique. Et la plus apaisante est peut-être celle qui swingue, car elle diffuse une douce chaleur, et génère dans la foulée un bien-être qui fait instantanément se sentir mieux. Qui d'autre que Count Basie pourrait incarner le mieux cette pulsation indicible ? Personne, sauf évidemment son frère d’armes, au moins son égal, j’ai nommé Oscar Peterson.
Ces deux diaboliques compères n’ont pas leur pareil pour faire chanter le spleen et tenir l’âme en lévitation. Ils se sont tellement souvent livrés à ce jeu subtil ensemble ! La magie de Youtube permet de les retrouver dans quelques sessions extatiques, dont celle-ci, datant de 1974, à l'occasion du festival de jazz de Prague. Ou bien une autre, émaillée de dialogues savoureux, enregistrée en 1980, avec le fin et élégant guitariste Jim Hall, et une section rythmique douce comme le plus chatoyant des velours damassés, associant l’excellent Niels Henning Orsted-Pedersen à la basse et le pétillant Martin Drew à la batterie… On retient notamment un Blue And Sentimental qui vaut toutes les romances, toutes les plus tendres divagations…
On retrouve Oscar Peterson en 1987 capturé au Japon, en compagnie des mêmes musiciens sans Basie hélas, et avec David Young à la basse.
Enfin, sans image, mais saisies magnifiquement dans l’intimité d’un studio feutré, deux sessions extatiques ont été gravées pour le compte de la maison Pablo :
Satch & Josh 1975 avec Louie Bellson (batterie), Freddie Green (guitare), Ray Brown (basse) et Satch & Josh again en 1977 où John Heard remplace Ray Brown.
Mon Dieu, faites que nos imbéciles de politiciens, parmi la multitude de mesures ineptes qu’ils nous imposent, ne parviennent pas durablement à nous couper la lumière pour nous empêcher de voir la beauté d’une ville la nuit, si propice au Blues…
26 octobre 2022
Intermezzo #3
Dédiée par le duo imaginaire “Florestan et Eusebius”, à la bien-aimée Clara, elle illustre la gémellité ontologique de toute chose, de tout sentiment, de tout principe. De fait, le musicien se dédouble et se montre ainsi tantôt impétueux et fantasque, tantôt rêveur et mélancolique, pour exprimer sa passion.
La mélodie suit un parcours d’une amplitude magnifique dont la scansion épouse parfaitement les transports complexes de l’âme. On passe souvent du legato le plus effusif au staccato aussi explosif qu’impérieux. Il y a beaucoup de ruptures dans le rythme de cette pulsation intime, mais à chaque fois ce qui pourrait se rompre ne fait que rebondir avec plus de force. On est porté par de fulgurantes ascensions aériennes qui s'épanouissent, à l’instar d’une pyrotechnie incandescente, en cascades éblouissantes.
Le premier mouvement commence avec une douceur infinie, un poco adagio, avant de prendre son envol en majesté, emportant tout au passage, au sein d'une effervescence tourbillonnante.
Une apaisante aria vient comme une pause langoureuse qui offre l’occasion d’une méditation mélancolique.
Puis la chevauchée reprend de plus belle avec la vivacité joyeuse et cataractante du scherzo, pour s'achever en apothéose sur un finale tourmenté, tantôt interrogatif, tantôt bouillonnant, voire martial, mais également indiciblement serein… Une éblouissante aventure romantique en somme, et une sublime incantation à l'amour et à la liberté, tout en fulgurances !
Parmi les interprétations magistrales de cette œuvre, il y a celle trop peu connue de Jean Martin, celle émouvante de la très regrettée Catherine Collard et plus récemment celle, d'une liberté splendide, d'Alexandre Kantorov.
Illustration: Bateaux dans le Port de La Rochelle. Acrylique 2022
24 juillet 2022
Paolo is back !
Paolo Nutini, alors un tout jeune homme d’à peine 20 ans, avait déjà une présence magnétique sur scène. De fait, il n’avait pas grand chose à envier à la star rayonnante qu’était alors Amy Winehouse et n’était manifestement pas intimidé de côtoyer les mythiques Rolling Stones.
Bonne pioche en quelque sorte car le débutant allait rapidement faire des étincelles. En trois albums, il acquit une stature internationale et imposa dans le monde la pop music une personnalité très originale. These Streets, Sunny Side Up, Caustic Love regorgent de pépites dont le style est fait d’un savant mélange de soul, de rock, de funk et de folk, émaillés par le grain superbe de sa voix, chaude et rauque dans les graves, impérieuse et déchirante dans les aigus.
Son génie avait semble-t-il déjà atteint son firmament en 2014, et personnellement je fus définitivement conquis par la très belle prestation qu’il donna cette année-là pour le festival i-Tunes à Londres. Dans un cadre intimiste, magnifiquement entouré par des musiciens hors pair, il y délivra une succession de hits dans lesquels il est bien difficile de rejeter quoi que ce soit. Les racines soul de son inspiration s’imposaient en majesté dans une reprise de Let Me Down Easy, titre autrefois chanté par la lumineuse Bettye Lavette. Suivit une composition personnelle, Coming Up Easy, dans la même veine, bercée par une rythmique torride, arrosée de cuivres juteux que n'aurait pas désavoué Otis Redding. Better Man était un exemple poignant de l’ensorcelant slow burner qui était devenu sa marque de fabrique. On retrouvait cette puissance émotionnelle dans le vibrant hymne à la liberté qu’est Iron Sky. Enfin, l'hypocoristique ballade Candy sonnait comme une sorte d’apothéose de cette période illuminée d’un artiste arrivant à maturité.
Hélas, après cette date, Paolo Nutini, peut-être un peu déstabilisé et fatigué par cette ascension vertigineuse autant qu’éprouvante, rentra dans une retraite créative dont il ne sortit qu’à l’occasion d’une ou deux apparitions publiques. On eût pu le croire perdu comme tant de vedettes météoriques, sitôt apparues, sitôt disparues…
C’est donc avec un mélange de joie et d’appréhension qu’on assiste à son retour en 2022 avec un nouvel opus, Last Night In Bittersweet.
Heureusement, dès la première écoute, le doute n’est plus permis: le filon n’est pas épuisé et la verve est intacte !
Pas moins de 16 nouvelles compositions témoignent de la richesse inventive d’un artiste revenu encore un peu plus mûr, plus assuré, plus sophistiqué également dans les arrangements musicaux. On retrouve dans ces chansons l’élégance, l’évidence, la force émotionnelle qui ancrent son style dans la constellation du rock.
21 avril 2022
The Beatles Get Back !
The Beatles Get Back, c’est le titre de la mini-série compilant les dizaines d’heures de film enregistrés sur le vif lors de l’élaboration du dernier album du légendaire groupe de pop music britannique. Un premier montage avait abouti en 1970 à un film raté, tombé bien vite dans les oubliettes. Aujourd’hui, c’est à un joyeux bain de jouvence auquel le réalisateur Peter Jackson nous convie. Certes il y a des séquences répétitives, puisqu’il s’agit de capter l’esprit de répétitions.. Elles lasseront peut-être un peu les béotiens, mais sûrement pas les fans, avides de la moindre révélation.
Il s’agissait hélas du chant du cygne puisqu’on était tout près du split final, mais quelle apothéose ! Et quelle joie de retrouver ces quatre garçons au meilleur de leur inspiration, dans l’ambiance de liberté débridée de la fin des sixties et d’épanouissement artistique. Quelques petites querelles naissent bien, ici ou là, mais la magie opère plus que jamais. Tout ce que ces gars touchaient se transformait en or et on reste bouche bée devant l’apparente simplicité avec laquelle ils se délestaient de mélodies devenues universelles et indémodables. On croirait les sessions tournées la semaine dernière tant elles gardent de fraîcheur, et tant la musique a conservé de jeunesse, d’originalité et de vigueur. Au surplus, les images sont superbes et la prise de son épatante.
On voit ainsi littéralement naître sous nos yeux les chansons Get Back, Let It Be, Don’t let me Down, The long And Winding Road… fruits d’une alchimie confondante de naturel et d’évidence.
On ne peut que ressentir une profonde mais chaude nostalgie en voyant le groupe faire une ultime prestation publique sur le toit de leur maison d’enregistrement, en plein mois de janvier ! Face au miracle de la création et devant l'évidence du génie, me revient la question d'un enfant à un sculpteur en train de terminer une statue équestre: “Mais comment savais-tu qu’il y avait un si beau cheval à l'intérieur de la pierre ?”
NB: à voir sur Disney+ en 3 épisodes de plus de deux heures chacun. Une sortie en Blu-ray est annoncée, mais pas avant plusieurs mois.
16 février 2022
Splendeur de Bach
Trois artistes illustrent l’éternel renouveau du cantor de Leipzig à l’occasion d'enregistrements récents d'œuvres pour clavier.
David Fray vient de revisiter les variations Goldberg. Disons le tout de suite, cette nouvelle version n’apporte rien de fracassant par rapport à toutes celles qui l’ont précédée. Le toucher est toutefois délicat, le phrasé souple et léger et David Fray adopte un jeu très sobre, sans fioriture inutile, mais non dénué de sensibilité, d’élégance et de liberté. Ce serait donc une version très honorable, parmi bien d’autres, si l’oreille n’était désagréablement écorchée par un grésillement qui parasite très souvent la mélodie. Il est particulièrement net à l’écoute de la première variation mais il sévit tout au long de l’œuvre, notamment dans les forte. Cette défaillance dans la prise de son, très étonnante à notre époque, gâche hélas singulièrement le plaisir. On pourra donc préférer les récentes versions de Lang Lang, Zhu-Xiao Mei, ou encore celle de Céline Frisch au clavecin. Une fois n’est pas coutume ce n=bon vieil instrument à cordes pincées est ici exploité de manière splendide.
Vikingur Ólafsson, jeune artiste islandais apporte quant à lui toute sa fougue pour proposer une vision très originale et décapante, de quelques préludes, fugues et autres variations, inventions et sinfonias. On retient notamment dans ce florilège rafraichissant et acidulé, presque iconoclaste, la version, transcrite pour piano par August Stradal, de la sonate pour orgue BWV 528. Non moins surprenant est l’arrangement du à Alexander Siloti du prélude en mi mineur BWV 855. Il se dégage de ces interprétations une quiétude enivrante, comme nimbée de froides mais cristallines vapeurs de banquise. Un vent de fraîcheur et de jeunesse souffle sur Bach dont on peut dire avec émerveillement avec Ólafsson qu’il est “un miroir pour toutes les générations”.
Rarement on vit plus de grâce mélodique enfin que dans la vision donnée par Piotr Anderszewski du second livre du Clavier Bien Tempéré. Au travers d’extraits choisis et ordonnés au gré de l’artiste on peut apprécier son toucher subtil, tendre, mais très sûr, servi par un legato parfait. La prise de son est ici sublissime, faisant admirablement ressortir la rondeur du piano et son aptitude magique à rendre toute la quintessence du génie musical et spirituel de Bach. On pourrait regretter que cette vision de l'œuvre monumentale de ce dernier ne soit que fragmentaire, mais on ne peut dénier à l’interprète le droit de faire un choix. On aimerait simplement, vu le bonheur qu’on éprouve, qu’il nous en donne davantage ! A écouter et réécouter indéfiniment…
30 août 2021
Let It Roll, Charlie
On ne présente pas Charlie Watts, batteur en titre et membre fondateur des Rolling Stones.
ll était toutefois si discret, si modeste, qu'on remarquait à peine, derrière le trio déchainé de rock stars embrasant l'avant scène, celui qui tenait de main de maitre les baguettes de la section rythmique.
Je savais que ce fameux groupe de Pop Music qui décoiffe et enchante la planète Rock depuis presque 60 ans, avait ses racines profondément ancrées dans le blues, mais j'ignorais tout de la carrière parallèle de son batteur, au service du jazz et du Boogie Woogie. Je découvre donc un peu tard mais avec beaucoup de plaisir et un brin de nostalgie les sessions endiablées auxquelles Charlie avait participé avec les pianistes Axel Zwingenberger, Ben Waters, et le bassiste Dave Green (The A,B,C & D of Boogie Woogie).
Marquées par un swing étincelant, elles s'inscrivent sans démériter auprès des légendaires et décapantes prestations du célébrissime quatuor britannique. A côté du déluge de watts célébrant avec fougue le Rock ‘N’ Roll, on trouve un Watts jazzy, tout simple, gai et rafraîchissant.
“Je suis béni”, disait Keith Richards, “le batteur avec qui j’ai commencé est l’un des meilleurs du monde. Avec un bon batteur, on est libre de faire tout ce qu’on veut !”
C'est donc un grand seigneur du Rock, du Blues, du Jazz et de la musique tout court qui s'en va...
03 juillet 2021
Lord Jim
Dans un morne Paris nocturne
L’ombre énamourée de la Mort
Enlace la ville qui dort
Tel un fantôme autour d’une urne
La fin du héros taciturne
S’inscrit dans un étrange sort
Qui le prive de tout ressort
Et l’offre au sommeil de Saturne
Déjà il erre entre deux eaux
L’esprit ailleurs, les yeux mi-clos
Sourd à tout chant, toute musique
Dans un navrant bain de minuit
Il a enfin noyé l’ennui
Et l’angoisse métaphysique.
14 octobre 2020
Bach au Zénith
Chaque nouvelle interprétation des Variations Goldberg constitue pour moi un évènement. Certes elles sont si nombreuses qu’il devient bien difficile de trouver encore quelque originalité dans la manière d’exprimer ce que contient cette partition merveilleuse.
Cette œuvre fut transcrite de tant de manières, qu’on se demande ce qu’on peut encore proposer. On en connaît des versions pour clavecin naturellement, puisque c’est pour cet instrument qu’elles furent écrites. Pour piano, c’est non moins évident depuis que Glenn Gould s’y est aventuré avec bonheur. Mais que dire des interprétations pour guitare, pour accordéon, pour trio à cordes, ou même pour orchestre de jazz ?
Sans doute avant tout que cette œuvre a quelque chose d’unique et d’universel, et qu’elle se prête sans être dénaturée à toutes les conceptions et à toutes les extrapolations aussi fantaisistes soient-elles. Le bonheur qu'elle procure est inusable et incorruptible et fascine autant que l’éclat de l’or ou du diamant.
Quoique sceptique de prime abord, je dois dire que je fus conquis dès la première écoute.
Il n’y a rien de vraiment révolutionnaire dans la manière choisie par l’artiste pour aborder ce Graal musical. Le parcours suivi est linéaire, sage et orthodoxe. Tout au plus peut-on mentionner le tempo, sensiblement plus lent que celui adopté par la plupart de ses prédécesseurs (hormis Rosalyn Tureck), mais sans aller jusqu’à l’extrême ralentissement confinant à l’extase hiératique qu’Anton Batagov conféra aux partitas. Tout de même, les plus de 10 minutes consacrées à la 25è variation en forme d’adagio presque romantique, n’en sont pas si loin…
Cela donne une intensité particulière à ces moments durant lesquels l’interprète semble se fondre dans la musique. Ici, il n’y a plus ni fioriture, ni effet de style, c’est limpide et bouleversant (variations 13, 15, 20, 25)).
A mesure que défilent les variations, ce qui frappe, c’est la plénitude du piano. Favorisée sans doute par une prise de son quasi parfaite, avec juste ce qu’il faut de réverbération et une belle rondeur harmonique, elle doit également à la douceur maîtrisée du toucher. Son velouté n’exclut pas vigueur et précision dans les attaques conférant une musicalité indicible aux lignes mélodiques et leur donnant un caractère tantôt joyeux tantôt apaisé mais toujours très affirmé. Bref, ce parcours est un pur enchantement, et procure à l’âme autant de jouissance, d’apaisement et de “récréation de l’esprit” que Bach le souhaitait, à n’en pas douter.. A ceux à qui ces réjouissances ne suffiraient pas, Lang Lang offre une autre version, non moins belle, mais enregistrée en public, au pied même du tombeau de Bach, suivant en cela l’exemple de Zhu Xiao Mei...
27 juillet 2020
Black Peter
In memoriam Peter Green (1946-2020)
Il affectionnait la pénombre
Où l'acuité de son regard
N’abandonnait rien au hasard
Pour voir la beauté la plus sombre
Mais il craignait la foule en nombre
La gloire et le trop plein d’égard
Qui, le savait-il, tôt ou tard
Vous font lâcher la proie pour l’ombre
Alors, timide et vacillant
Mais l’esprit et les doigts agiles
Il s’abstint des choix trop faciles
Son génie fut un pur diamant
Mi-blues et mi-métaphysique
Toujours taillé pour la musique...
20 juillet 2020
Dylan Is Dylan
Le style est des plus dépouillés. Les lignes mélodiques sont réduites à leur plus simple expression, et l’accompagnement musical mi-swing mi-shuffle, se fait velours pour servir d’écrin à des textes intenses, débordant de poésie et de symboles.
Le morceau de bravoure c’est évidemment la très longue mélopée Murder Most Foul qui brode autour de la mort de John Kennedy, l’histoire de la seconde moitié du XXè siècle, et plus précisément la décade prodigieuse des sixties, exaltante, chaotique et tragique. Plus que jamais Bob Dylan apparaît comme le chantre inspiré de cette époque qu’il incarne si bien tout en la contemplant de haut, tel un oiseau au regard acéré mais quelque peu désabusé.
A côté de ce monument, on trouve une floraison de superbes ballades qui égrènent leur litanie dans un clair obscur tiède et paisible. Key West par exemple qui célèbre de façon inattendue l’éden suspendu au bout de la Floride, entre les bleuités confuses de l'océan et la clarté nébuleuse des confins célestes. “Key West est l'endroit où il faut être lorsqu’on cherche l'immortalité” dit la chanson. C'est une vanité bien sûr mais elle est envoûtante et on se prend à espérer que continue longtemps cette incantation qui love sa douce espérance sur un lit moelleux d'accordéon.
Avec I’ve made up my mind to give myself to you, Dylan chante l’amour de la manière la plus déchirante qui soit. Revenu de tout et abordant le crépuscule de son existence, le barde s'y fait très humble et résigné pour célébrer l'essentiel et oublier tout le reste. Est-ce à un être humain qu'il s’adresse et à qui il s'abandonne corps et âme, est-ce à une entité supérieure, peu importe en somme. Les mots sont là, ils touchent profondément, voilà tout.
D’autres petits trésors gravitent autour de ces splendides astres nocturnes. Deux blues à la rythmique lourde et capiteuse qui rappellent où se trouvent les racines peut-être les plus profondes de la geste dylanienne (False Prophet, Goodbye Jimmy Reed). Dans le premier, l’artiste assène une fois encore qu’il se refuse à être un faux prophète (“je ne sais que ce que je sais, et je vais là où seuls vont les solitaires…”). Dans le second, il salue bien bas l’un des ténébreux héros de la culture américaine, auprès desquels il puise souvent son inspiration. A noter d'ailleurs que le titre improbable de l’album, fait référence à une chanson de Jimmie Rodgers, l’un des pionniers de la musique country.
Il faut enfin s'imprégner de la beauté de quelques perles noires, à la scansion aussi absconse qu’ensorcelante (Crossing The Rubicon, Black Rider, I Contain Multitudes, Mother Of Muses, My Own Version Of You).
Et puisque tout compte dans cet album sombre et somptueux, un mot enfin de la pochette et du cliché qui l'illustre. Il vous plonge dans la demi-clarté d’un bouge interlope aux reflets mordorés de came et d'alcool. On y danse jusqu’au bout de la nuit dans une ambiance où la volupté des rêves amoureux le dispute à la poisse des destinées enfermées dans une implacable finitude...