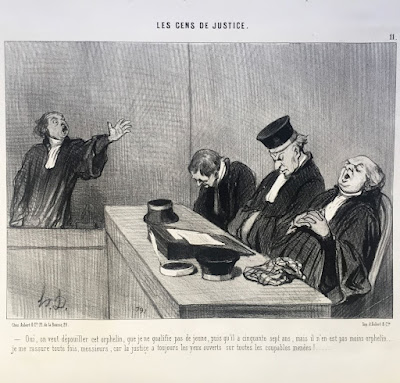Cela faisait un bail que je cherchais à me procurer cet ouvrage de Henry de Montherlant (1895-1972), dont le seul titre exerçait sur moi une étrange fascination. L’Amour relève d’une telle évidence qu’il peut sembler incongru, voire insensé d’en questionner le fondement même, ou de chercher à en percer les arcanes. Mais à bien y réfléchir, n’y a-t-il pas là un vrai sujet dont la portée philosophique s’impose à l’entendement ?
J’avais vu autrefois le bouquin dans les rayonnages de la bibliothèque de mon père. Pourtant, si l’interrogation sur laquelle il se fonde avait pénétré mon esprit, je n’avais jamais tenté de le lire, ni d’ailleurs quoi que ce soit d’autre de l’écrivain. Était-ce l’allure sévère, empreinte d’un stoïcisme hautain de l’homme qui m’effrayait, ou bien était-ce sa réputation sulfureuse et sa moralité ambigüe qui m’avaient rebuté, je ne saurais trop dire…
Toujours est-il que, taraudé par la question, je décidai, longtemps après avoir laissé filé le livre dans les limbes du temps, de revenir à lui, de me mettre en quête d’un nouvel exemplaire, puis de me plonger enfin dedans avec délectation.
Après avoir ingurgité le dernier Houellebecq, je dis dire que le contraste est des plus frappants. Même s’il ne s’agit sans doute pas d’un fleuron dans une œuvre très dense, il s’agit ici sans aucun doute de littérature. Le style, la fantaisie, l’originalité, les ellipses, les images, l’esthétique, l’assise culturelle, tout y est, même la tragédie qui affleure de manière poignante sous la légèreté du propos. Et tant pis si l’accès à un tel texte est sans doute moins aisé que celui qui mène à l'anéantissement houellebecquien…
Ce récit fut achevé en juillet 1972, quelques semaines à peine avant la fin tragique du romancier survenue le 21 septembre. A l’instar de l’illustre torero Belmonte qui se suicida parce qu’il ne voulait pas atteindre le seuil fatidique de la vieillesse fixé par lui à 70 ans, Montherlant, que l’âge avait rendu presque aveugle, choisit l’équinoxe d’automne, moment où le jour est égal à la nuit, pour faire le grand saut.
Juste avant la fin programmée de son existence, comme un astre revenu à son point de départ, il avait focalisé ses ultimes réflexions sur trois personnages, héros de ses tout premiers romans : Jacques Peyrony, modèle du jeune homme tonique et sain au profil musclé digne des athlètes de l’antiquité, Dominique S., l'incarnation féminine de la pureté du sport féminin, qui à la fois “imposait” et “attendrissait” l’écrivain, et Douce, dont on ne connaîtra que le surnom, qualifiant “une jeune fille aussi charmante qu’inconstante, l’archétype même de la femme.”
Pour ses trois personnages, Montherlant avait une vraie affection et sans doute davantage. Du moins le croyait-il…
Cherchant à percer le mystère de l'attachement qui le liait à eux, à comprendre pourquoi ils avaient disparu de sa vie, et afin de corriger les maladresses de style qui entachaient selon lui la description qu’il fit de leurs relations passées, il se fait un devoir de reprendre le fil de deux écrits de jeunesse, Le Songe et Les Olympiques. Au long d’un chemin littéraire déconcertant fait de digressions dispersées façon puzzle, il est ainsi amené tantôt à magnifier les qualités, ou bien au contraire à revoir à la baisse les mérites de ces êtres chers. En toile de fond de ces chassés croisés sentimentaux, se profilent tour à tour l’admiration de l’écrivain pour le sport, sa passion pour la corrida et enfin l’empreinte obsédante de la guerre, celle de 14 avant tout.
Mais c’est dans les derniers chapitres que l’histoire dévoile tout son potentiel dramatique. Car hélas dans ce récit où l’amour le dispute à l’amitié, chacun des trois personnages fera défaut : “Successivement Dominique, Peyrony, Douce tombaient de moi comme à un souffle plus fort tombent de l’arbre ses feuilles un peu mortes.”
A la tristesse que lui inspire cette finitude sentimentale, Montherlant tente bien d’opposer un échappatoire réconfortant, fait de pensées positives: “De Dominique je dirai qu’elle m’a fourni une héroïne intéressante, dont je n’ai pas su tirer parti. De Peyrony qu’il remplit Les Olympiques, qui ne seraient pas ce qu’elles sont sans lui…/…. De Douce que, pendant neuf ans, elle avait été avec moi une fille parfaite : volupté, simplicité, honnêteté.”
Mais au bout du compte, le constat de la vanité de ce qu’on appelle amour s’impose. Aimons-nous vraiment ceux que nous aimons ? Telle est la question.
A celle-ci, l’auteur répond sans détour : “Nous n’aimons que des moments”. Pire, ces instants eux-mêmes sont illusoires marqués par une exigence absurde: “nous demandons aux autres de nous donner un amour que nous ne leur donnons pas.” Tout est donc vain car “les objets eux aussi sont des moments…” ils finissent un jour ou l’autre par s’user et disparaître. En somme, il n’y a “rien à dire si on sait bien d’avance que tout est perdu, soi compris.”
En bon stoïcien, Montherlant fait toutefois un effort pour se reprendre. En ayant conscience de cette insignifiance, dit-il, c’est malgré tout, “une conscience que nous devons surmonter, car il faut aimer. Il faut vivre dans cette illusion et dans cette clairvoyance : elles sont l’une et l’autre à l’honneur de l’homme, et les juxtaposer est encore à son honneur…/…”
Mais alors qu’on croit la cause entendue, un post scriptum inopiné de l’auteur révèle qu’il fait régulièrement un rêve qualifié de “révélateur”. Dans celui-ci, l’évidence s’impose qu’une personne a indéfectiblement compté dans sa vie. L’amour existe donc mais “on n’aime qu’une fois”.
Qui était donc l’être dont le souvenir habitait ses rêves ? Appartenait-il seulement au monde réel ? S’agissait-il de Serge, tel qu’il est dépeint dans l’intrigante pièce de théâtre “la ville dont le prince est un enfant” ? Quelqu'un dont le nom ne peut être dit ou bien qui s'est effacé avec le temps ?
Loin de porter un quelconque espoir, cette pensée s’ouvre hélas “sur la désolation” car avec le temps, l’amour s’est de toute manière enfui. Terrible constat qui amène la déchirante conclusion : “Depuis ce matin, ce n’est pas le « Ouvrez-vous, portes éternelles » que j’écrivais dans un de mes Carnets. C’est « Fermez-vous, portes éternelles…. »
J’avais vu autrefois le bouquin dans les rayonnages de la bibliothèque de mon père. Pourtant, si l’interrogation sur laquelle il se fonde avait pénétré mon esprit, je n’avais jamais tenté de le lire, ni d’ailleurs quoi que ce soit d’autre de l’écrivain. Était-ce l’allure sévère, empreinte d’un stoïcisme hautain de l’homme qui m’effrayait, ou bien était-ce sa réputation sulfureuse et sa moralité ambigüe qui m’avaient rebuté, je ne saurais trop dire…
Toujours est-il que, taraudé par la question, je décidai, longtemps après avoir laissé filé le livre dans les limbes du temps, de revenir à lui, de me mettre en quête d’un nouvel exemplaire, puis de me plonger enfin dedans avec délectation.
Après avoir ingurgité le dernier Houellebecq, je dis dire que le contraste est des plus frappants. Même s’il ne s’agit sans doute pas d’un fleuron dans une œuvre très dense, il s’agit ici sans aucun doute de littérature. Le style, la fantaisie, l’originalité, les ellipses, les images, l’esthétique, l’assise culturelle, tout y est, même la tragédie qui affleure de manière poignante sous la légèreté du propos. Et tant pis si l’accès à un tel texte est sans doute moins aisé que celui qui mène à l'anéantissement houellebecquien…
Ce récit fut achevé en juillet 1972, quelques semaines à peine avant la fin tragique du romancier survenue le 21 septembre. A l’instar de l’illustre torero Belmonte qui se suicida parce qu’il ne voulait pas atteindre le seuil fatidique de la vieillesse fixé par lui à 70 ans, Montherlant, que l’âge avait rendu presque aveugle, choisit l’équinoxe d’automne, moment où le jour est égal à la nuit, pour faire le grand saut.
Juste avant la fin programmée de son existence, comme un astre revenu à son point de départ, il avait focalisé ses ultimes réflexions sur trois personnages, héros de ses tout premiers romans : Jacques Peyrony, modèle du jeune homme tonique et sain au profil musclé digne des athlètes de l’antiquité, Dominique S., l'incarnation féminine de la pureté du sport féminin, qui à la fois “imposait” et “attendrissait” l’écrivain, et Douce, dont on ne connaîtra que le surnom, qualifiant “une jeune fille aussi charmante qu’inconstante, l’archétype même de la femme.”
Pour ses trois personnages, Montherlant avait une vraie affection et sans doute davantage. Du moins le croyait-il…
Cherchant à percer le mystère de l'attachement qui le liait à eux, à comprendre pourquoi ils avaient disparu de sa vie, et afin de corriger les maladresses de style qui entachaient selon lui la description qu’il fit de leurs relations passées, il se fait un devoir de reprendre le fil de deux écrits de jeunesse, Le Songe et Les Olympiques. Au long d’un chemin littéraire déconcertant fait de digressions dispersées façon puzzle, il est ainsi amené tantôt à magnifier les qualités, ou bien au contraire à revoir à la baisse les mérites de ces êtres chers. En toile de fond de ces chassés croisés sentimentaux, se profilent tour à tour l’admiration de l’écrivain pour le sport, sa passion pour la corrida et enfin l’empreinte obsédante de la guerre, celle de 14 avant tout.
Mais c’est dans les derniers chapitres que l’histoire dévoile tout son potentiel dramatique. Car hélas dans ce récit où l’amour le dispute à l’amitié, chacun des trois personnages fera défaut : “Successivement Dominique, Peyrony, Douce tombaient de moi comme à un souffle plus fort tombent de l’arbre ses feuilles un peu mortes.”
A la tristesse que lui inspire cette finitude sentimentale, Montherlant tente bien d’opposer un échappatoire réconfortant, fait de pensées positives: “De Dominique je dirai qu’elle m’a fourni une héroïne intéressante, dont je n’ai pas su tirer parti. De Peyrony qu’il remplit Les Olympiques, qui ne seraient pas ce qu’elles sont sans lui…/…. De Douce que, pendant neuf ans, elle avait été avec moi une fille parfaite : volupté, simplicité, honnêteté.”
Mais au bout du compte, le constat de la vanité de ce qu’on appelle amour s’impose. Aimons-nous vraiment ceux que nous aimons ? Telle est la question.
A celle-ci, l’auteur répond sans détour : “Nous n’aimons que des moments”. Pire, ces instants eux-mêmes sont illusoires marqués par une exigence absurde: “nous demandons aux autres de nous donner un amour que nous ne leur donnons pas.” Tout est donc vain car “les objets eux aussi sont des moments…” ils finissent un jour ou l’autre par s’user et disparaître. En somme, il n’y a “rien à dire si on sait bien d’avance que tout est perdu, soi compris.”
En bon stoïcien, Montherlant fait toutefois un effort pour se reprendre. En ayant conscience de cette insignifiance, dit-il, c’est malgré tout, “une conscience que nous devons surmonter, car il faut aimer. Il faut vivre dans cette illusion et dans cette clairvoyance : elles sont l’une et l’autre à l’honneur de l’homme, et les juxtaposer est encore à son honneur…/…”
Mais alors qu’on croit la cause entendue, un post scriptum inopiné de l’auteur révèle qu’il fait régulièrement un rêve qualifié de “révélateur”. Dans celui-ci, l’évidence s’impose qu’une personne a indéfectiblement compté dans sa vie. L’amour existe donc mais “on n’aime qu’une fois”.
Qui était donc l’être dont le souvenir habitait ses rêves ? Appartenait-il seulement au monde réel ? S’agissait-il de Serge, tel qu’il est dépeint dans l’intrigante pièce de théâtre “la ville dont le prince est un enfant” ? Quelqu'un dont le nom ne peut être dit ou bien qui s'est effacé avec le temps ?
Loin de porter un quelconque espoir, cette pensée s’ouvre hélas “sur la désolation” car avec le temps, l’amour s’est de toute manière enfui. Terrible constat qui amène la déchirante conclusion : “Depuis ce matin, ce n’est pas le « Ouvrez-vous, portes éternelles » que j’écrivais dans un de mes Carnets. C’est « Fermez-vous, portes éternelles…. »