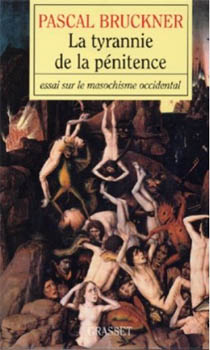Ouvrage salutaire que l'essai de Pascal Bruckner sur « le masochisme occidental ».
S'inscrivant comme suite logique à son désormais célèbre « sanglot de l'homme blanc », il frappe juste en montrant les effets pervers de la culpabilité obsessionnelle vis à vis des fautes du passé, devenue la marque de l'Europe et tout particulièrement de la France.
Certes notre continent a beaucoup à se faire pardonner, mais il est d'autant plus étonnant de le voir verser dans une repentance aussi morbide, qu'il semble avoir réussi à vaincre ses principaux démons : communisme, fascisme, impérialisme colonisateur...
Bruckner flétrit la tendance actuelle à vouloir systématiquement prendre le parti des vaincus, des rebelles et des auto-prétendus opprimés, jusqu'à se dresser contre ses propres alliés et à ériger des brutes en héros. Il évoque à ce propos, la longue liste des tyrans et des illuminés successivement encensés par une intelligentsia irresponsable et donne en dernier lieu l'exemple de la figure « christique » du Palestinien.
Elle ressuscite en effet la notion de « bon sauvage » et cristallise en elle toute la culture de l'excuse, qui aboutit à transformer d'anciennes victimes en bourreaux. Par un incroyable tour de passe passe idéologique, les Juifs deviennent ainsi des oppresseurs au seul motif que leur existence contrarie les desseins de la nation arabe. Tout comme le fait de vouloir résister au communisme équivalait il y a peu de temps encore pour certains, à prôner le fascisme.
Loin de les inciter à progresser, ce dérèglement des sens conduit à infantiliser et déresponsabiliser nombre d'excités du tiers monde en excusant leur comportement actuel par leurs peines passées. On en vient d'ailleurs à se demander s'il s'agit de stupidité ou de lâcheté : « on s'agenouille devant les fous de dieu, on accepte leur révolte, et on bâillonne ou on ignore les libres penseurs. »
Bruckner montre qu'avec une mauvaise conscience aussi dogmatique, et en recherchant trop opiniâtrement les fautes anciennes, on laisse entendre que tout individu est une victime potentielle. « Chacun de nous acquiert en naissant un portefeuille de griefs qu'il devra faire fructifier. » De cette manière, on ne referme pas les plaies, on en crée de nouvelles : « j'étais malheureux, je ne le savais pas ».
Appliquée aux affaires intérieures du pays cette logique amène une étrange manière de penser : l'anticolonialisme sert de marxisme de substitution à toute une gauche en perte de compréhension du monde, l'anti-libéralisme et l'alter-mondialisme remplacent les illusions socialistes perdues.
On voit l'empreinte maléfique de la « Loi du marché » partout et même dans les aléas climatiques, et on finit « par lire les Minguettes ou la Courneuve avec les lunettes des Aurès ou des hauts plateaux du Tonkin »...
L'auteur constate parallèlement que « le romantisme de la souffrance » se conjugue dans un monde voué au culte de l'hédonisme, avec une « allergie à la douleur », l'idéal étant « d'acquérir le titre de paria sans avoir jamais rien enduré. »
Les nouveaux résistants sont en effet bien souvent « des héros de combats terminés. » Ils sont d'autant plus virulents que le risque lié à leurs prises de position est faible. Ils cultivent un devoir de mémoire intransigeant sur les drames du passé mais se révèlent d'une incurable myopie ou bien complaisants sur les maux actuels : Cambodge, Rwanda, Bosnie, Darfour, Tchétchénie, Corée, Irak, Iran...
Les responsables politiques, conscients des réalités mais pétrifiés par la crainte d'apparaître « réactionnaires », donnent des gages contradictoires. Ils affirment « comprendre » la jeunesse délinquante mais organisent avec force publicité contre elle des raids policiers tapageurs peu efficaces. Ils renvoient quelques sans-papier vers leur pays d'origine tout en régularisant la situation d'autres plus médiatisés. Ils cultivent l'ambiguïté en mélangeant « discrimination positive » et « immigration choisie ». Ils annoncent à grands frais quelques mesures sociales démagogiques tout en se livrant à une privatisation pusillanime des monopoles d'état, ils disent vouloir alléger, et "moderniser" la pression fiscale mais pérennisent un impôt aussi idéologique, absurde et stérilisant que l'ISF...
Résultat, par son attitude à la fois répressive et laxiste, libérale et néo-collectiviste « la République se met en position de perdre sur tous les fronts. »
Il y a dans cet ouvrage un constat pertinent des maux qui rongent notre société.
Au titre des critiques, on peut toutefois regretter une organisation générale un peu confuse. Cette impression est renforcée par l'excès de notes de bas de page et le surgissement de curieux encadrés en fin de chapitre, dont on ne comprend pas bien la signification vu qu'ils sont souvent sans lien évident avec ce qui précède.
La thèse n'est d'autre part, pas exempte de contradictions.
L'auteur reproche par exemple à la France « la détestation qu'elle se porte à elle-même », une « jubilation morose à se déprécier », et l'instant d'après il l'accuse au contraire de « s'identifier avec l'universel », de « se gargariser de sa grandeur ».
Un peu plus loin, s'attaquant vertement à l'anti-américanisme, il ne peut pourtant pas s'empêcher de sortir le traditionnel couplet anti-Bush accusant notamment l'administration actuelle de « rompre de façon inquiétante avec l'alliance d'empirisme de bon sens et d'enthousiasme qui a toujours caractérisé l'Amérique. » Plus fort, il qualifie même l'entourage du président « d'anciens bolcheviks passés à droite», et de « lobby néo-impérialiste » ! Quant à George W. Bush, il le dépeint comme « le messager antipathique de la liberté » !
C'est dommage, car venant à la fin de l'ouvrage ça en atténue un peu la portée.
Il faut en effet décider si le fait de porter haut l'étendard de la démocratie et de ses convictions constitue une qualité ou un défaut.
On peut lire par exemple que la démocratie résulte d'une « lente maturation », ce qui suggère qu'elle ne peut être imposée par la force, et qu'en terre musulmane elle ne s'établira « qu'à partir de l'islam et non dans sa négation », contrairement semble-t-il à ce que feraient actuellement les Américains.
Or, à l'inverse de ces affirmations, on a vu la démocratie s'installer de manière brutale et sanglante, et pourtant durablement au Japon et en Allemagne. Jamais enfin, en dépit d'une indéniable naïveté et de maladresses, l'administration Bush dans son grand dessein de faire progresser la liberté, n'a remis en cause l'islam lui-même, surtout pas en Irak.
Ces réserves mises à part, on ne peut que tomber d'accord avec l'exhortation avec laquelle Bruckner conclut son exposé : « Que l'Europe chérisse la Liberté comme le bien le plus précieux, et l'enseigne dès l'école aux enfants. »